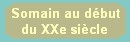CHAPITRE XVII
DE BEAUREPAIRE A SESSEVALLE
CREATION D'UNE
PAROISSE MINIERE
Le quartier de Beaurepaire était autrefois le centre religieux de
Somain avec le prieuré et la grande chapelle Notre-Dame des Orages . Mais la
révolution a mis fin à cette existence religieuse . Seule la petite chapelle
Notre-Dame des Orages construite en 1823 fait référence au passé religieux de
cette partie de la paroisse .
La découverte d'un filon carbonifÈre à
proximité de Beaurepaire et l'implantation d'une population destinée à
l'exploitation de la fosse donne le signal d'une renaissance de Beaurepaire .
Les populations miniÈres , qui sont relativement éloignées de Saint-Michel , ont
besoin des secours de la religion .
Mais en ces temps d'anticléricalisme et
de désengagement de l'Etat , comment envisager la création d'une paroisse ? Les
Mines d'Aniche vont-elles prendre le relais de l'Etat ? Comment les mineurs de
Beaurepaire vivent-ils la religion catholique ?
A - DE LA CREATION DE LA FOSSE A LA CITE MINIERE ( 1899 - 1908
)
1 - Création de la fosse
a - découverte du gisement
Depuis
1773 , la Compagnie des Mines d'Aniche exploite la concession obtenue par le
Marquis de Traisnel . Mais seule une partie de cette vaste concession est
exploitée . Des recherches sont entreprises en fin de siÈcle dans des zones non
encore exploitées . En 1899 , on découvre un faisceau houiller à la limite
des trois communes de Villers-Campeau , Rieulay et Somain . Le filon découvert
fait apparaÎtre un charbon de qualité "maigre-quart-gras" qui permet de
diversifier la production car la Compagnie d'Aniche produit essentiellement du
charbon "gras" .
b - la fosse "De Sessevalle"
La nouvelle fosse est
baptisée "De Sessevalle" en l'honneur d'Anatole de Sessevalle qui fut directeur
de la Compagnie de 1869 à sa mort en 1902 . La fosse est foncée en 1901 au
diamÈtre de cinq mÈtres sur le territoire de Villers-Campeau dans un gisement
vierge . L'exploitation commence en 1904 par les veines Henri et Anatole , dans
un riche gisement de charbons maigres d'exploitation assez facile . DÈs 1906 ,
la production atteint 200000 tonnes puis 332000 tonnes en 1908 . Un second puits
d'un diamÈtre de quatre mÈtres est creusé en 1905 et entre en service en 1908
.
Le nouvel établissement devient en quelques années relativement important
au sein de la Compagnie d'Aniche : De Sessevalle représente 17 % de la
production totale de la Compagnie en 1908 .
Le nouveau siÈge semble appelé à
un avenir confortable .
2 - Création d'une cité attenante à la fosse
La difficulté
pour les Mines d'Aniche réside dans l'embauche des ouvriers . En effet , le
marché du travail est trop exigu‰ . Les compagnies miniÈres se livrent une
concurrence féroce à l'embauche . De plus , il faut attirer des ouvriers qui
n'appartiennent pas déjà à la Compagnie pour ne pas dépeupler les autres puits .
Aussi , on s'efforce de débaucher les mineurs des compagnies voisines , on
embauche d'anciens ouvriers agricoles qui démarre dans le métier , on accepte
des ouvriers étrangers . Mais cela n'est pas suffisant ; le site n'attire pas ,
il n'y a pas assez d'avantages consentis . Pourtant , le métier de mineur est
bien rémunéré , mieux que les verreries d'Aniche ou les métallurgistes de
Denain . Mais le travail est dur et peu considéré .
Pour
remédier à cette situation , la Compagnie d'Aniche décide de construire une cité
miniÈre attenante à la fosse . L'offre faite par la Compagnie produit son effet
car l'habitat représente pour l'ouvrier un avantage certain . La proximité
fosse-coron permet d'augmenter les rendements et la productivité grâce à une
moindre fatigue du mineur lors du déplacement . Les nouvelles habitations sont
décentes . Avec les autres avantages consentis aux mineurs , on peut considérer
que la Compagnie pourvoit à tout .
La solution adoptée par les Mines
d'Aniche est un succÈs comme l'indique le curé de Somain :"A peine terminées ,
les maisons étaient prises comme d'assaut par les nouveaux venus et plus d'un
arrivant eut beaucoup de peine à transporter ses meubles de la route de Rieulay
à sa demeure à travers l'amoncellement des matériaux de toute sorte destinées
aux constructions" . Trois cités sont construites dÈs 1906 à proximité
immédiate du carreau de la fosse . En 1908 , 364 logements sont opérationnels .
La population du hameau compte presque 1800 âmes en 1909 . Cette arrivée subite
gonfle le poids démographique de Somain : la population augmente sensiblement en
cinq ans : 7050 habitants en 1906 , 9611 habitants en 1911 soit un accroissement
de 36,3 % ( + 7,2 % par an ) ; c'est le plus fort taux d'accroissement de la
commune . La fosse exploitera en 1928 plus de 2500 mineurs !
Le hameau
, construit presque exclusivement sur la commune de Somain , est un entité à
part entiÈre . Relativement excentré par rapport au centre-ville , il acquiert
dÈs le départ une certaine autonomie . Quant au terme de Beaurepaire , il
disparaÎt au profit de celui de "Sessevalle" . Le quartier est le hameau de la
Compagnie . Toutes les activités sont tournées vers la fosse . C'est elle qui
domine et "emprisonne" le mineur toute sa vie . Le curé de Somain loue la
politique sociale et paternaliste des Mines d'Aniche :"360 maisons couvrent déjà
ce sol prédestiné , alignant leurs gais pignons sur de magnifiques allées et
offrant aux ouvriers un séjour peu coûteux , bordé de jardinets jalousement
cultivés , une situation hygiénique exceptionnelle et à proximité du travail
quotidien" .
3 - Sur le plan religieux
a - bénédiction de la fosse
La
Compagnie des Mines d'Aniche fait montre depuis le milieu du dix-neuviÈme siÈcle
d'un grand intérêt pour la chose religieuse . Elle possÈde des chapelles , elle
paie des chapelains , elle emploie des congrégations religieuses pour ses écoles
et pour les soins des ouvriers . Les noms de baptême de ses fosses sont souvent
religieux . Ajoutons enfin qu'une partie des administrateurs de la Compagnie est
composée d'industriels sucriers de la région de Cambrai ( Delloye - Dejardin )
proches semble-t-il de l'administration diocésaine .
Mais l'intérêt porté
aux questions religieuses n'est pas toujours innocent . En effet , il semble que
la Compagnie compte sur le soutien des religieux pour socialiser ses ouvriers .
C'est donc tout naturellement que la Compagnie des Mines d'Aniche sollicite le
clergé somainois pour la bénédiction de la fosse "De Sessevalle" . La cérémonie
a lieu le 21 juillet 1902 en présence de tous les administrateurs et
ingénieurs . Le curé de Somain , revêtu du rochet et de l'étole , adresse
en la circonstance quelques paroles de remerciement à la Compagnie :"Je vais à
votre demande appeler le secours de Dieu sur cette fosse et en même temps la
placer sous la protection de la Sainte-Vierge qui a été honorée ici-même sous le
nom de Notre-Dame des Orages . Au milieu de ce monde qui ne veut plus de Dieu et
qui nous fait la guerre , c'est une bien grande consolation que d'être appelé
par une compagnie aussi distinguée que la votre à bénir cette fosse de
Sessevalle" . Puis l'abbé Buzin récite les priÈres inspirées par l'Eglise pour
ce genre de bénédiction et , suivi de tous ces messieurs , il parcourt les
dépendances du puits , les arrose d'eau bénite en récitant le "Miséréré" .
La
collaboration entre la Compagnie et le clergé est certaine . Cette collaboration
peut permettre : au clergé de sauvegarder un esprit chrétien dans une population
sujette à la déchristianisation , à la Compagnie d'utiliser le clergé pour
socialiser les mineurs afin de noyer toute contestation . Mais cette entente
peut déclencher chez les mineurs un rejet du catholicisme considéré comme allié
des patrons contre leurs intérêts .
b - une population peu religieuse
La
communauté appartient au monde de la mine . La quasi-totalité des hommes
travaillent à la fosse . Mais la difficulté de trouver des ouvriers a déterminé
l'embauche d'éléments souvent disparates : des régionaux , des étrangers (
belges , polonais originaires de la ruhr ) . Mais surtout la Compagnie emploie à
de Sessevalle les mineurs les plus acharnés et les plus contestataires licenciés
par la Compagnie d'Anzin aprÈs la grÈve de 1906 qui a suivi la catastrophe de
CourriÈres . Aussi , la population du hameau est largement convertie aux
doctrines socialistes et anticléricales .
Au départ , le hameau de Sessevalle
dépend de Saint-Michel . Mais cette charge supplémentaire occasionne beaucoup
trop de travail au curé et à ses deux vicaires . L'abbé Buzin éprouve des
difficultés pour répondre aux sollicitations des mineurs ( bénédiction des
maisons notamment ) . Mais surtout il perçoit la croissance de l'indifférence
religieuse . Aussi , il doit faire beaucoup pour tenir en main les personnes
sujettes à l'abandon des pratiques . Trop peu de mineurs se rendent à la messe
dominicale en prétextant l'éloignement de l'église paroissiale . Le curé de
Somain craint que le temps mette fin à la vie chrétienne de ses paroissiens d'un
genre particulier :"Si on le laisse grandir ( le hameau ) et se compléter sans
exercices religieux , parmi eux , il s'y formera une population sans Dieu et si
pas ennemie , au moins indifférente à toute pratique religieuse" . Il
plaide sa cause auprÈs de la Compagnie d'Aniche en espérant que celle-ci fera un
geste ; il sollicite un local pour aller y dire la messe et faire le catéchisme
:"C'est une dépense essentielle devant laquelle j'espÈre que l'administration ne
reculera pas" .
Pour réussir dans son entreprise , il compte sur le soutien
de son cousin , le vicaire général Massart , lui-même familier de l'ingénieur
directeur de la Compagnie des Mines d'Aniche Lemay . Le souhait du
vice-doyen est pris en considération . Des négociations s'engagent entre
l'administration diocésaine , la Compagnie d'Aniche et le clergé somainois . Le
deux septembre , l'abbé Buzin fait état de l'avancement du projet :"... à
l'heure qu'il est , nous sommes en plein projet de bâtir église et presbytÈre à
Beaurepaire ..." . Les négociations aboutissent : la Compagnie des Mines
d'Aniche prend en charge la construction d'une église , d'un presbytÈre et d'une
salle de patronage . En fait , c'est de la création d'une véritable paroisse
qu'il s'agit . Cette solution satisfait le curé de Somain qui estime que les
mineurs demandent une orientation pastorale particuliÈre . En outre , la
relative autonomie du hameau par rapport à Somain sort renforcée par la
constitution d'une paroisse .
L'aboutissement du projet met en exergue les
excellentes relations entretenues entre les Mines d'Aniche et le clergé
somainois . On a vu avec la bénédiction de la fosse que le curé de Somain a une
bonne opinion de la Compagnie . Il considÈre que la politique sociale et
religieuse de la Compagnie est bienfaitrice pour les ouvriers :"Les
administrateurs de la Compagnie d'Aniche savent que leurs ouvriers ont une âme ,
et qu'il ne suffit pas de leur procurer le bien-être du corps , mais qu'il faut
penser encore au bien de l'âme . Et , avec une admirable munificence , ils ont
résolu de bâtir une grande église avec une demeure pour le prêtre qui la
desservira" .
B - UNE PAROISSE A DE SESSEVALLE
1 - La construction de l'église
La construction de l'ensemble
paroissial dure deux ans ( 1908 à 1910 ) . La premiÈre pierre de l'église est
posée et bénite par le vice-doyen Buzin le 2 juillet 1908 . Une croix est
plantée sur l'emplacement du futur autel par "délégation de monseigneur
l'archevêque" . Des photos d'époque témoignent de la tenue de cette cérémonie .
"On y voit le curé Buzin en camail , en train de prononcer les paroles
canoniques devant un parterre de personnes endimanchées et d'ouvriers en tenue
de travail" .
L'emplacement choisi pour le site de la nouvelle église
est distant de quelques trois cent mÈtres des corons proprement dits . Les
travaux débutent en 1908 . La Compagnie des Mines d'Aniche voit grand et
l'édifice projeté n'est pas une simple chapelle mais une grande église
cruciforme . Le presbytÈre est construit à proximité immédiate de l'église . Un
patronage est également mis en chantier : il a usage de salle de catéchisme ,
salle des fêtes , salle couverte pour abriter le patronage des enfants , salle
de réunion pour les sociétés et confréries . Tout cet ensemble permet une vie
religieuse animée dans des locaux adéquates .
Cependant tout n'est pas si
simple . Le vocable de l'église déterminé par le curé Buzin engage le clergé de
Somain et de Rieulay dans une querelle interminable .
2 - Le choix du vocable
L'abbé Buzin choisit le vocable de
Notre-Dame des Orages pour la nouvelle église de De Sessevalle en référence à
l'ancienne chapelle . Si ce choix semble insolite vu la particularité miniÈre du
hameau , cet intitulé a un rapport certain avec la fosse depuis que le
vice-doyen l'a placée sous cette divine protection lors de la bénédiction de la
fosse en 1902 . L'origine du vocable remonte au passé moyenâgeux .
La
chapelle Notre-Dame des Orages fut détruite à la révolution et la statue de la
vierge jetée dans un fossé . Recueillie par un habitant de
Marchiennes-Campagne , elle fut remise au curé de Rieulay au concordat .
Le fait de posséder l'antique statue permet à la paroisse de Rieulay d'établir
une fête à Notre-Dame des Orages le 2 juillet . En 1865 , l'abbé Becquart ,
nouveau prêtre de Rieulay , veut intensifier le culte : il développe la
procession qui prend un caractÈre régional , il établit une confrérie , fait
frapper des médailles et imprimer des images sous ce titre . Les bénéfices
permettent à la cure de Rieulay de se doter d'une nouvelle église paroissiale
plus en rapport avec la dévotion .
Mais la paroisse de Somain , qui a
reconstruite une petite chapelle en 1823 , n'abandonne pas la dévotion . La
messe traditionnelle est célébrée tous les 2 juillet à cinq heures ; c'est le
jour de l'assomption , le 15 ao-t , que les somainois se rendent en procession à
la chapelle Notre-Dame des Orages décorée pour la circonstance . Du haut de la
chaire improvisée , un prêtre adresse des exhortations à la foule en chantant
les litanies et en récitant le chapelet . Puis la procession reprend sa marche
au son du magnificat en direction de l'église Saint-Michel par l'avenue de
Beaurepaire et la route de Marchiennes . "L'enthousiasme de ces pieuses foules
était humilié du modeste sanctuaire de sa puissante protectrice" . Cette
citation du curé Buzin est significative : il regrette ardemment de ne pas
pouvoir construire une chapelle plus en conséquence de la dévotion . Or la
chance lui sourit :"Mais voici que la divine providence , par ses voies
admirables , amÈne ici une population ouvriÈre à qui il faut une église . Par la
générosité de la Compagnie , cette église s'élÈve déjà plus belle et plus grande
que nous n'aurions pu la bâtir en l'honneur de Notre-Dame des Orages et dans un
an sa statue pourra quitter son trop modeste sanctuaire pour entrer en triomphe
dans sa vaste église" .
3 - La querelle entre Somain et Rieulay à propos du vocable
a -
le début de la querelle
Le curé de Rieulay rentre dans une colÈre noire
lorsqu'il apprend la nouvelle en 1909 . Il attire l'attention de
l'administration diocésaine sur :"le grand inconvénient qu'il y aurait pour plus
tard à avoir deux fêtes rivales l'une de l'autre car il est à supposer que le
curé de Notre-Dame de Sessevalle , voudra célébrer dignement la fête de la
patronne de son église" . La réponse du vicaire général Catteau ne le
rassure guÈre :"Nous ignorons sous quel vocable a été posée la premiÈre pierre
...". Cependant , il l'assure que si le vocable choisi était celui de Notre-Dame
des Orages , "on lui substituerait un autre titre le jour o- l'église serait
bénite , ... , Rieulay ne sera pas dépossédé" . On peut s'étonner du fait que
l'archevêché ne connaissait pas le nom de baptême de l'église alors que la pose
de la premiÈre pierre a été faite par délégation de monseigneur l'archevêque .
Le vice-doyen de Somain s'efforce de calmer le jeu en expliquant dans sa
notice sur Beaurepaire , qui parait dans Le Régional d'avril à juillet 1909 ,
l'ancienneté de la dévotion fondée à Somain . Le 11 juillet 1909 , en guise de
conclusion , il annonce officiellement que l'intitulé "Notre-Dame des Orages"
sera le nom de baptême de la nouvelle église de De Sessevalle . Mais il ajoute
pour apaiser les esprits :"Mais loin de nous la pensée de porter ombrage à qui
que ce soit . La paroisse de Rieulay , fille de la paroisse de Somain , possÈde
l'antique statue et par le zÈle de l'ancien curé Becquart , est devenu le centre
de la dévotion et de la confrérie de Notre-Dame des Orages , ainsi que le siÈge
d'un pÈlerinage régional . Mais elle ne peut trouver mal que la paroisse
d'origine de cette dévotion garde , le deux juillet , sa messe traditionnelle à
cinq heures et sa procession du quinze août . S'il y a une difficulté , c'est
pour cette messe qui , depuis que la chapelle est détruite , est chantée à
l'église paroissiale de Somain . Maintenant la chapelle pourra satisfaire à ce
devoir traditionnel et faire revivre l'ancien temps d'avant la révolution" .
Cette conclusion ne tranquillise pas le curé de Rieulay , l'abbé Dhaussy . Une
querelle s'amorce inévitablement . Elle va rebondir lors de la confirmation de
l'intitulé de la nouvelle église de De Sessevalle en 1910 .
b - la
bénédiction de l'église de De Sessevalle
L'orage ecclésiastique qui s'amorce
se fera sans la présence de l'abbé Buzin qui décÈde le 16 novembre 1909 et qui
par conséquent ne voit pas la réalisation de son projet . L'église achevée , on
procÈde à la bénédiction de la cloche le 3 juillet 1910 puis de l'église
elle-même le 31 juillet 1910 ; le matin à dix heures a lieu la bénédiction
solennelle de la nouvelle église dédiée à la Sainte-Vierge sous le vocable de
Notre-Dame des Orages . La cérémonie est présidée par monseigneur Massart ,
chancelier de l'archevêque spécialement délégué à cet effet . Les
administrateurs et ingénieurs de la Compagnie miniÈre , de nombreux
ecclésiastiques de la région assistent à la bénédiction . A cette occasion ,
l'abbé Vindevogel , premier curé de De Sessevalle , fait éditer un souvenir
qu'il distribue à ses paroissiens .
c - "un orage ecclésiastique"
Le nom de baptême se voit confirmer par la bénédiction . Pourtant , le curé
de Rieulay n'est pas resté inactif . En avril 1910 , il s'interroge dans une
lettre au vicaire général Catteau sur l'inscription "Notre-Dame des Orages"
gravée au-dessus de la grand-porte de l'église de De Sessevalle :"N'y aura-t-il
pas lieu de craindre des inconvénients pour l'avenir ? votre décision ( de 1909
) sera-t-elle suffisamment respectée ?" . Le vicaire général s'efforce de
rassurer cette fois encore le curé en promettant qu'il n'y aura jamais de
pÈlerinage à Notre-Dame de Orages à De Sessevalle . Cependant , il affirme ,
contrairement aux assurances données en septembre 1909 , que le nom donné à
l'église lors de la pose de la premiÈre pierre est irrévocable ! . Cette
volte-face inquiÈte l'abbé Dhaussy qui continue à alerter l'autorité diocésaine
. Mais celle-ci , visiblement embarrassé , ne répond plus . Le desservant de
Rieulay demande à son Doyen de servir d'intermédiaire en juin 1910 . Ce
dernier semble ne pas se faire d'illusions sur les suites de l'affaire .
d -
l'implication de la Compagnie des Mines d'Aniche
Une solution de compromis
semble avoir été envisagée en mars 1910 . L'abbé Vindevogel , vu la
lettre-réponse du vicaire général du 19 août 1909 , aurait été disposé à changer
de vocable pour celui de Notre-Dame de Lourdes alors que l'abbé GuéquiÈre était
plut"t partisan de celui de "Sacré-cœur" .
Mais ces solutions échouent . La
Compagnie des Mines d'Aniche , propriétaire de l'église , entend conserver le
vocable choisi par l'abbé Buzin . L'abbé GuéquiÈre en aurait d'ailleurs prévenu
le curé de Rieulay en ses termes :"Vous avez affaire à plus fort que vous : la
Compagnie . Vous n'arriverez pas à avoir gain de cause" . Aussi , l'abbé Dhaussy
s'en fait l'écho auprÈs de son Doyen : "Comment peut-on expliquer qu'une
Compagnie purement industrielle puisse s'immiscer si puissamment dans une
décision d'ordre strictement religieux ?" . En fait , l'archevêché se sent
redevable à la Compagnie de cet effort pour le culte catholique . La date
fatidique du 31 juillet approche ; le conseil de paroisse de Rieulay et l'abbé
Dhaussy réitÈrent leurs demandes d'explications à l'administration
diocésaine . Une réponse du vicaire général ...Massart ( cousin de
Buzin ) parvient à Rieulay :"Il n'est nullement question d'établir à De
Sessevalle un pÈlerinage en l'honneur de Notre-Dame des Orages , ni d'en
réclamer la statue vénérée , pour l'église de ce hameau ou pour celle de Somain
. Messieurs les curés de Somain et de De Sessevalle sont prêts à signer un
engagement dans ce sens . Mais nous n'avons pu refuser à la Compagnie des Mines
d'Aniche le titulaire qu'elle a réclamé pour son église ..."
e - le curé de
Rieulay en appelle à Rome
Le curé de Rieulay n'abdique pas . Il demande
conseil à un religieux assomptionniste qui fait ses études théologiques à Rome ,
à un professeur de droit-canon à l'université catholique de Paris sur
l'opportunité d'une requête . Une seule possibilité s'offre à lui : il doit
saisir le Saint-siÈge afin de solliciter un indult de la congrégation des Rites
. Va-t-il aller jusqu'à cette extrémité ? il n'hésite plus tant la procession du
15 août 1910 à Somain , relatée par Le Régional , l'exaspÈre au plus haut point
. Le 29 août , il envoie un dossier complet à l'archevêque coadjuteur
monseigneur Delamaire pour demander un nouvel arbitrage . Le desservant attend
une réponse qu'il ne reçoit pas : on a encore choisi de l'ignorer . Une ultime
provocation sessevalienne persuade définitivement l'abbé Dhaussy
qu'il faut en appeler à Rome . L'archevêché de Cambrai réagit enfin et prévient
le curé de Rieulay par l'intermédiaire du Doyen Margerin de la probable
inutilité de son entreprise :"Monseigneur l'archevêque ne reviendra certainement
pas sur son attitude qu'il a prise au sujet du vocable de Notre-Dame des Orages
. Le curé de Rieulay veut faire un procÈs à son évêque ! Qu'il marche ! Mais il
perdra certainement son procÈs ... Nous trouverons des arguments pour
nous
défendre et pour triompher" . Pour constituer un dossier solide , l'abbé
Dhaussy demande les conseils du pÈre Gonzalez du collÈge espagnol de Rome . Le
pÈre Gonzalez répond aux vœux de l'abbé Dhaussy :"Vous devez vous informer bien
si la Compagnie a mis dans la fondation de l'église de Sessevalle la clause
acceptée par l'évêque qu'elle porterait le titre de la Sainte-Vierge des Orages
parce qu'alors notre cause serait perdue ... Le cas de si la Compagnie a influé
plus ou moins sur l'esprit de l'évêque ne porte aucun avantage sur votre cause
parce qu'on comprend facilement qu'elle a influé et cela au moyen de bénéfice" .
Le 29 novembre 1910 est remise la plainte du curé de Rieulay à la congrégation
des Rites . Entre-temps , le Doyen de Marchiennes exhorte le curé Dhaussy à
démissionner :"Attaquer son archevêque est chose grave et grosse de
conséquence ... Acceptez-donc votre changement et laissez à un autre le soin de
terminer cette affaire" . Mais Dhaussy ne désarme pas ; la réponse qu'il envoie
au Doyen est explicite :"Nous demandons une chose juste et il n'y a pas de
raison de nous blâmer ... Il importe non d'avoir raison personnellement mais de
savoir simplement s'il est permis à un curé de défendre les droits de sa
paroisse jusqu'au bout".
Le 15 janvier , le jugement est rendu : d'un seul
mot , "acquiescat" ( qu'il obéïsse ) , l'abbé Dhaussy est débouté . Le pÈre
Gonzalez souligne l'ambiguïté de la décision lorsqu'il évoque à Dhaussy sa
conversation avec le secrétaire de la congrégation qui lui aurait dit :"Nous
n'avons pas donné tort au prêtre , nous avons dit seulement acquiescat".
Il
est vrai qu'il est difficile de donner raison à un simple prêtre même dans son
droit contre son évêque quand on sait l'importance de la hiérarchie dans
l'Eglise catholique . Cette affaire , qui se termine sur une fin de non-recevoir
, reste lourde de conséquences : les deux paroisses voisines restent longtemps
en mauvais termes . Quant à l'abbé Dhaussy , il rompt avec un ultramontanisme
autrefois militant .
C - LA VIE PAROISSIALE
Le hameau a désormais sa paroisse . Cette autonomie
religieuse avec église , presbytÈre et patronage est renforcée par le fait que
le prêtre de la communauté ouvriÈre est l'homme de la Compagnie : elle le paie ,
lui alloue le presbytÈre et le soutient dans son ministÈre . L'abbé Vindevogel
est donc quasiment indépendant de la paroisse Saint-Michel de Somain .
1 - Un prêtre démocrate
Jean Vindevogel est le premier prêtre à
assurer le service pastoral dans la nouvelle église Notre-Dame des Orages .
Né le 17 août 1869 à La Madeleine dans une famille modeste , le jeune
Jean se destine à la carriÈre ecclésiastique lors de ses études secondaires
d'Hazebrouck o- il compte parmi ses professeurs le célÈbre abbé Lemire qui y
enseigne la philosophie et la rhétorique :"Il fut pour beaucoup qui entrÈrent
dans le sacerdoce un maÎtre admiré autour de qui ils se rangÈrent lorsque ,
député , il devint une maniÈre de symbole" . L'abbé Lemire , qui rêve d'un
rapprochement entre les classes supérieures et les classes inférieures de la
société , est l'apôtre du catholicisme social en France . Jean Vindevogel est
profondément impressionné par le personnage . Ordonné prêtre le 30 juin 1895 à
l'âge de vingt-six ans , il reste fidÈle tout au long de sa carriÈre à
l'enseignement professé par l'abbé Lemire . Rallié à la république , fortement
imprégné par l'encyclique Revum Novarum du pape Léon XIII sur la condition des
ouvriers , l'abbé Vindevogel reçoit des postes en phase avec ses
orientations : successivement vicaire à Haspres ( 1895 - 1896 ) , à
Villers-Outréau ( 1896 - 1903 ) et à Saint-Nicolas à Valenciennes ( 1903 - 1909
) o- il est au contact des réalités quotidiennes des ouvriers .
Aussi , sa
nomination dans le hameau ouvrier de De Sessevalle le premier mars 1910 revêt un
caractÈre de continuité : on dénote en lui un charisme social capable de
s'intégrer en terre délicate pour l'Eglise . S'il doit loger à Somain les
premiers temps , il se rend chaque jour auprÈs de ses nouveaux paroissiens chez
qui il prend rapidement un ascendant :"Jusqu'à l'achèvement de l'église et du
presbytÈre , le curé de De Sessevalle demeurera à Somain et y dira la messe mais
il se rendra chaque jour auprÈs de ses paroissiens pour les catéchismes et les
visites aux malades" . L'abbé Vindevogel fait rapidement sentir au vice-doyen
GuéquiÈre qu'il n'entend pas lui être subordonné . Il profite du fait qu'il est
salarié de la Compagnie pour agir en totale autonomie du curé de Somain . Cette
situation engendre parfois des frictions entre les deux coreligionnaires .
2 - Une vie religieuse animée
Le jour de la bénédiction de l'église , le 31 juillet 1910 ,
l'abbé Vindevogel procÈde aux baptêmes de dix-neuf enfants . La Croix s'en fait
l'écho :"La cérémonie , unique sans doute en son genre , eut lieu ensuite . Il
s'agissait du baptême de vingt-quatre enfants ( erreur certainement dans la
transcription ou exagération volontaire ? ) de De Sessevalle , dont certains
avaient huit ou neuf ans . Ceci est tout à l'honneur de Monsieur l'abbé
Vindevogel qui , on le voit , a su depuis peu de temps conquérir l'estime et la
confiance de ses nouveaux paroissiens" . En fait , l'arrivée du chapelain
permet de pallier l'insuffisante présence religieuse des années précédentes
.
Une vie religieuse comparable à n'importe quelle paroisse s'installe donc
avec offices dominicaux à sept heures et dix heures , vêpres l'aprÈs-midi à
seize heures . Mais l'aspect le plus significatif de la vie religieuse est la
création par l'initiative de l'abbé Vindevogel de divers groupements et
confréries . Le curé peut compter sur un noyau de chrétiens qui se dévouent pour
la cause catholique . Le 31 juillet , un groupe de jeunes gens assurent en
public le chapelain qu'ils l'aideront dans son ministÈre . La confrérie de
Saint-Ghislain groupe mÈres et enfants avec fête annuelle le premier lundi qui
suit le 15 août . Une société de Sainte-Barbe regroupe les mineurs qui
souhaitent célébrer leur sainte-patronne . Le patronage bénéficie de la
disponibilité des locaux offerts par la Compagnie : on y fait du théâtre ; la
société est forte de cent-vingt membres . Des fêtes y sont données tout au long
de l'année . Par exemple , on organise le 11 janvier 1914 la fête des Oeuvres et
la Consécration à la Sainte-Famille . Le dimanche est le jour de réunion
au patronage : les hommes viennent y jouer aux cartes , au billard , les jeunes
gens et les jeunes filles y ont leurs distractions . Divers stands proposent une
buvette , des pâtisseries , des frites ou des confiseries . La chorale
paroissiale est forte d'une cinquantaine de membres . Le chantre-organiste est
également jardinier au presbytÈre ( il est rétribué par la Compagnie ) .
L'harmonie de De Sessevalle participe aux cérémonies religieuses .
Il nous
est impossible de mesurer une quelconque pratique religieuse du hameau .
Cependant , il semble que la population sessevallienne soit largement
déchristianisée ou plus simplement indifférente à la chose religieuse .
D'ailleurs , l'arrivée de cette nouvelle population précipite en 1912 l'élection
d'un socialiste au fauteuil majoral . Par ailleurs , il semble que les habitants
assimile la fête chrétienne de Sainte-Barbe à la fête du hameau : une grande
majorité des habitants célÈbre la fête des mineurs . Cependant , l'indifférence
et la volatilité de certains paroissiens à cette occasion sont significatifs .
Le quatre décembre 1909 , la pluie contrarie le défilé qui se forme à la suite
de la messe ; les mineurs se répandent alors dans tous les estaminets avoisinant
l'église Saint-Michel , seuls quelques irréductibles continuent le défilé
.
L'abbé Vindevogel a donc un exercice difficile dans un hameau
sociologiquement uniforme . Par ailleurs , ses soucis pastoraux sont compliqués
par une nouvelle contestation .
3 - Une nouvelle contestation
Une nouvelle contestation
éclate entre Somain , De Sessevalle et Rieulay . Le problÈme de l'intitulé de
l'église est encore chaud , la rancune rieulaysienne est tenace . Une nouvelle
controverse est soulevée à propos du Marais des Onze-Villes , hameau de Somain
proche de Rieulay . Les habitants de ce hameau sont desservis par le curé de
Rieulay . Un accord tacite entre les deux paroisses est observé sauf en ce qui
concerne la publication des bans de mariage ( ces derniers continuent d'être du
ressort de la paroisse Saint-Michel ) . Cependant , l'apparition d'une paroisse
à De Sessevalle bouleverse ce schéma traditionnel .
Le 20 avril 1911 , les
habitants du marais adressent une pétition à l'archevêque et y dénoncent les
bruits qui font état d'un éventuel rattachement à De Sessevalle sur le plan
spirituel . Le curé de Rieulay soutient la demande de ses paroissiens en
envoyant une supplique au vicaire général Catteau :"Hélas , j'au déjà eu
beaucoup d'ennuis à Rieulay ... M. le curé de Sessevalle dit tout haut que
l'autorité diocésaine va prendre incessamment une décision pour rattacher à
l'église de Sessevalle , le hameau dit Marais des Onze-Villes ... Il commence à
déployer un zÈle qui parait inconsidéré pour attirer à son église les habitants
de ce hameau ... Cette conduite parait étrange" . Pour étayer son propos ,
l'abbé Dhaussy insiste sur l'importance financiÈre du marais pour Rieulay ( 35
francs pour les places occupées dans l'église ) . Le Doyen de Marchiennes
s'efforce de tranquilliser le desservant de Rieulay :"... La pétition des
habitants du Marais des Onze-Villes a beaucoup étonné ces messieurs de Cambrai .
Il n'a jamais été question de réunir ce hameau à la nouvelle paroisse de De
Sessevalle . On se demande qui a pu faire circuler un bruit qui ne repose
absolument sur rien . J'en suis heureux car je vous plaindrais d'être obligé de
lutter contre de nouvelles difficultés" .
Il semble que cette nouvelle
querelle soit la conséquence du refus du curé de Rieulay de faire célébrer la
premiÈre communion d'une enfant habitant le marais . Cette jeune fille aurait
fait sa communion à De Sessevalle .
Une nouvelle controverse naÎt
quelques mois plus tard entre le curé de Somain et celui de Rieulay à propos
d'un mariage . L'abbé Dhaussy prend une nouvelle fois la plume pour dire son
indignation au vicaire général Catteau :"Le curé de Somain a refusé que le
mariage d'une fille du marais se passe à Rieulay dans la mesure où
l'autorisation ne lui est pas demandée par le curé du lieu . Comme la personne
ne veut pas se marier à De Sessevalle , la cérémonie doit se faire et se fait à
Marchiennes-Ville paroisse du conjoint . Une telle exigence ne parait-elle pas
outrée de la part du curé de Somain ?". Les affaires se compliquent encore en
juin 1912 : l'abbé GuéquiÈre répond de maniÈre déterminée :"De quel droit
exercez-vous un ministÈre quelconque sur le Marais des Onze-Villes ? Mon
prédécesseur a pu vous accorder certaines permissions ... Ne deviez-vous pas
redemander ces permissions au successeur canoniquement installé à Somain ? ...
M. le curé de De Sessevalle est prÈs du Marais des Onze-Villes , c'est à lui que
je donne mes pouvoirs . Vous en êtes avisés". Le débat n'en devient que plus
âpre . Aussi , l'administration diocésaine sermonne le vice-doyen de Somain qui
met de l'eau dans son vin le 27 juillet 1912 :"Ce que je désire avant tout ,
c'est la paix ... Je veux bien les laisser choisir ... en ce qui concerne les
mariages , ... mêmes restrictions que du temps de l'abbé Buzin ... Cette
restriction s'applique à M. Vindevogel comme à vous ... Comme vous le voyez ,
vos fidÈles du Marais pourront continuer à réclamer tous les secours de votre
ministÈre".
Mais les choses sont encore trop floues pour le curé de Rieulay
qui regrette que le curé de De Sessevalle puisse visiter les marais aussi-bien
que lui-même .
Cette controverse est le signe du ferment d'incompréhensions
réciproques qui subsistent entre les trois entités religieuses .
Le hameau de De Sessevalle est doté d'un ensemble religieux
grâce à la Compagnie des Mines d'Aniche . Le prêtre , salarié de la Compagnie ,
fait parti du schéma à la fois patriarcal et paternaliste qui permet à la
Compagnie d'encadrer ses employés . Quant au curé de De Sessevalle , il
contribue à rendre dans ce quartier éminemment déchristianisé un semblant de vie
chrétienne .